
Le 7 décembre 1970, un rapport que les médias ont qualifié de « bombe à retardement » a été déposé à la Chambre des communes.
Le document de 488 pages débordait de recherches et d’analyses qui allaient en effet s’avérer fort dangereuses, menaçant de rompre l’ordre établi d’un pays où les hommes profitaient impunément du travail domestique non rémunéré de leurs épouses, d’une société où des contraintes légales empêchaient les femmes de jouir des droits de la personne récemment entérinés.
Ces pages contenaient de grandes idées. Des projets d’envergure. Un bouleversement sismique annoncé. Mais le rapport de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada, déposé il y a cinquante ans ce mois-ci, n’était pas une bombe.
Il s’agissait plutôt d’un coup d’envoi au second départ d’un marathon pour l’atteinte de l’équité hommes-femmes qui ébranlait déjà l’Occident d’après-guerre – une course d’endurance que nous nous éreintons encore à poursuivre un demi-siècle plus tard.
C’était la première prise de température auprès de la moitié de la population, un segment démographique qu’ignoraient les politiques publiques depuis… toujours. C’était le premier plan de match pour s’attaquer aux inégalités de genre à l’échelle nationale. Le rapport défendait le droit des femmes au respect et à une identité en dehors du foyer, ainsi qu’à une rémunération égale et au même accès à l’emploi que les hommes.
Il exigeait des réformes aux lois désuètes en matière d’impôts, de mariage et de divorce, et réclamait des modifications pressantes au Code criminel et aux lois sur l’immigration. Les solutions qu’il proposait aux inégalités sur le marché du travail, comme la création d’une infrastructure nationale pour la garde des enfants, étaient radicales pour l’époque. Eh oui, cette idée qui n’a pas encore vu le jour est vieille de plus de cinquante ans. Le premier ministre Lester B. Pearson a mis sur pied la commission en 1967, mais le mérite ne lui revient pas. C’est grâce aux femmes que cela s’est produit. Pendant des années auparavant, elles s’étaient organisées dans leur lutte pour que les droits des femmes soient reconnus comme des droits de la personne.

BIBIANE COURTOIS
Bibiane Courtois est infirmière de métier. Elle a adapté des programmes de santé aux besoins des communautés autochtones et a présidé pendant des années l’association Femmes autochtones du Québec, où elle a soutenu le projet de loi C-31, qui apportait des modifications à la Loi sur les Indiens. Elle a poursuivi son engagement en siégeant à la Commission des droits de la personne et au Conseil du statut de la femme du Québec.
Cette année-là, en novembre, le Comité pour l’égalité des femmes (CEWC) a présenté un mémoire au gouvernement fédéral, l’enjoignant à passer à l’action. Celui-ci fut ignoré, et Laura Sabia, qui était à la tête du CEWC, a alors déclaré « spontanément » qu’elle enverrait 2 millions de femmes manifester sur la colline parlementaire, comme l’écrit l’historienne des médias Barbara M. Freeman, professeure de journalisme à l’Université Carleton, dans son livre The Satellite Sex: The Media and Women’s Issues in English Canada, 1966-1971. « Si on doit recourir à la violence, avait dit Sabia à l’époque, on va le faire en maudit. »
Mais cela ne s’est pas avéré nécessaire. Dès le début de l’année 1967, le premier ministre a nommé la journaliste et animatrice Florence Bird à la tête d’une commission d’enquête qui plongerait au cœur de la vie des femmes canadiennes et produirait un rapport sur les manières de résorber les inégalités entre les hommes et les femmes. Le 3 février, la commission, formée de cinq femmes blanches et de deux hommes blancs, s’embarqua dans sa quête.
Cette commission s’est penchée sur l’égalité des chances des femmes par rapport à celles des hommes plutôt que sur le démantèlement des systèmes conçus pour défavoriser celles-ci, selon Joan Sangster, historienne du travail des femmes et professeure d’études des femmes et du genre à l’Université Trent.

FARRAH KHAN
Depuis vingt ans, Farrah Khan milite pour l’équité et pour mettre fin à la violence à caractère sexiste. Elle a été sélectionnée comme membre du Conseil consultatif sur l’égalité des sexes dans le cadre du G7 et, en 2018, elle a pris la parole devant les dirigeants des sept pays du groupe. Khan œuvre à titre de mentor chez femifesto, un organisme féministe qui vise à abolir la culture du viol au profit d’une culture du consentement. Avec femifesto, elle a créé le guide Use the Right Words: Media Reporting on Sexual Violence in Canada, à l’usage des journalistes.
Pendant six mois, la commission a sollicité plus de 470 mémoires et près d’un millier de lettres d’opinion de la part de femmes canadiennes. Elle a tenu des audiences dans 14 villes des dix provinces et dans le Nord, et y a recueilli près de 900 témoignages. Elle a également fait l’objet de nombreuses critiques, affirme Sangster. « Le rapport a été attaqué par des femmes de gauche. D’après elles, il négligeait les inégalités économiques structurelles – en particulier celles engendrées par le capitalisme. »
Les femmes de couleur se sont exprimées également : la journaliste et militante noire Carrie Best a officieusement critiqué le rapport pour son omission des enjeux fondamentaux auxquels font face les femmes noires et autochtones, indique Freeman. La militante Kanien’kehá:ka (Mohawk) Mary Two-Axe Earley demandait des modifications à la Loi sur les Indiens, qui stipulait que si une femme épousait un homme n’ayant pas le statut d’Indien, elle se voyait retirer le sien. Pour Malinda Smith, professeure en sciences politiques et vice-doyenne à l’équité, à la diversité et à l’inclusion de l’Université de Calgary, les rapports sur le statut de la femme au Canada tendent à dissimuler l’histoire raciste et colonialiste du pays et à camoufler ses pratiques discriminatoires actuelles. « En traitant toutes les femmes [racisées] comme des immigrantes, le rapport éclipse la complexité historique, tout en privilégiant les personnes d’ascendance anglaise et française. »
Les enjeux des communautés LGBTQ étaient également occultés, et le rapport ne s’attaquait pas à la pauvreté. On y mentionnait à peine la violence à l’encontre des femmes – une question que l’on considérait alors comme relevant de la sphère privée.
Malgré ces échecs et ces lacunes, Freeman estime que le rapport était révolutionnaire pour l’époque. « C’était un agent de changement dans la mesure où nombre des recommandations qu’il comprenait ont vu le jour et que plusieurs modifications ont été apportées », dit-elle.
Parmi celles-ci, on retrouve une meilleure représentation des femmes au gouvernement. Le rapport a donné lieu à des mesures inclusives, qui ont conduit à l’embauche d’un plus grand nombre de femmes. De nombreux stéréotypes ont été rayés des manuels scolaires distribués dans les écoles relevant du fédéral et couvertes par la Loi sur les Indiens – un geste qui a fini par percoler à l’échelle provinciale et dans le domaine de la radiodiffusion et des télécommunications, note Freeman. En 1971, le gouvernement fédéral a instauré un congé de maternité payé s’étendant jusqu’à 15 semaines, à 66 % du dernier salaire perçu par la mère. Même s’il a fallu attendre 1985, le gouvernement fédéral a fini par modifier la Loi sur les Indiens pour tenter de mettre fin à la discrimination basée sur le genre. Le rapport a également mobilisé les groupes de pression, qui se sont donné pour mission de garder à l’œil les législateurs afin de s’assurer que ceux-ci instituent ces changements de façon concrète.

JANAYA FUTURE KHAN
Janaya Future Khan inspire des personnalités comme Zendaya et Marc Jacobs avec ses Sermons du dimanche sur Instagram Live, qui abordent des sujets aussi variés que le mouvement Black Lives Matter (Khan a cofondé le chapitre canadien) et la brutalité policière, en passant par la théorie queer et le transféminisme. Sa mission personnelle est de se battre pour les droits des autres et de lutter pour transformer les conditions sociales et les attitudes qui sont à l’origine de différentes formes d’oppression.
L’un des groupes les plus influents, le Le Le Comité canadien d’action sur le statut de la femme était actif de 1971 au début des années 2000. Mais l’égalité – c’est-à-dire le fait d’être identique aux yeux de la loi — ne revient pas à l’équité, qui suppose de s’assurer que les individus ont les outils nécessaires pour survivre et s’épanouir dans un système qui n’est pas conçu pour tout le monde, dit Smith. Ça, c’est notre nouvel objectif. Et l’intersectionnalité, une perspective qui s’est développée dans les années 1980 pour cerner les privilèges et les préjudices concernant la sexualité, l’identité de genre, l’origine ethnique, l’âge, la capacité physique et la classe sociale, est désormais incontournable pour une nouvelle génération de féministes. La lutte pour la parité des genres se joue à présent par-delà la binarité.
« Mark Twain a dit que l’histoire ne se répète pas, mais que bien souvent, elle rime. Nous sommes dans un moment qui rime beaucoup », déclare l’économiste Armine Yalnizyan, actuellement chercheuse invitée sur l’avenir des travailleurs et travailleuses à la Atkinson Foundation. Entre la Marche des femmes et le mouvement #MeToo, il y a un retour de l’énergie révolutionnaire de la fin des années 1960 et du début des années 1970, fait remarquer Yalnizyan. Des angles morts subsistent, cependant, en particulier sur les questions économiques. Malgré les conclusions du rapport de 1970, qui ont relevé la valeur intrinsèque du travail non rémunéré, ajoute-t-elle, « le progrès demeure assimilé à la richesse matérielle. » La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière ces inégalités : les femmes sont souvent des travailleuses essentielles, dans des secteurs de services à faibles revenus, dans l’économie du soin. Ce sont aussi celles qui abandonnent leurs carrières pour faire l’école à la maison et s’occuper des enfants, ce qui a mené au plus important recul de la main-d’œuvre féminine depuis plus de trois décennies. Toutefois, l’espoir demeure permis. Dans le discours du Trône prononcé cet automne, le gouvernement a promis un plan de garde des enfants à l’échelle nationale dans le cadre de son programme de redressement pour pallier les ravages de la COVID-19.
Nous avons des précédents historiques pour poursuivre la course. Dans ce marathon, on peut dire que 2020, l’année pandémique, nous a atteints dans tous nos points faibles. Mais c’est dans la relance que nous voyons l’occasion de nous rapprocher, malgré tout, de l’équité.
L’égalité hommes-femmes en mots et en chiffres
Des voix à entendre et des statistiques à connaître
PAR TINA ANSON MINE
« La lutte des femmes pour leurs droits est une lutte inachevée. Il faut continuer aussi longtemps qu’il y aura des injustices »
Huberte Gautreau, militante pour l’équité hommes-femmes et cofondatrice du Carrefour pour femmes du Nouveau-Brunswick, une maison de transition qui vient en aide aux victimes de violence conjugale (Acadie Nouvelle, 2016).
« La garde des enfants financée par des fonds publics peut […] soutenir la croissance économique en accroissant la main-d’œuvre féminine et en élargissant l’assiette fiscale. La garde des enfants n’est pas une dépense, mais bien un investissement dans une économie plus équilibrée entre les hommes et les femmes, et donc plus résiliente. »
Jasmine R. Rezaee, directrice de la mobilisation et des communications chez YWCA Toronto ; Carolyn Ferns, coordonnatrice des politiques publiques et des relations gouvernementales à la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance ; et Janet Davis, ancienne conseillère municipale de Toronto (Now Magazine, 2020)
« Cette fois-ci, aucune femme ne sera abandonnée. »
Zanana Akande, la première femme noire élue à l’Assemblée législative de l’Ontario. (La marche des femmes de Toronto, 2018)
« Nous sommes une nation dysfonctionnelle à cause des oppressions passées. Mais il n’y a que nous qui puissions nous tirer de cette situation. Il y a encore parmi nous des gens qui peuvent nous enseigner les façons de faire des Premières Nations. Et, tout en cherchant la vérité, nous devons prendre soin de bien respecter tout le monde. »
Gloria May Eshkibok, actrice, chanteuse et organisatrice communautaire autochtone bispirituelle (Journée internationale des femmes à York University, mars 2000)
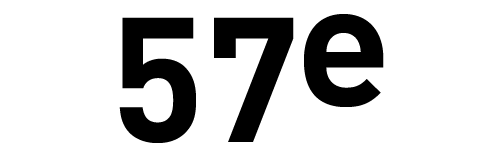
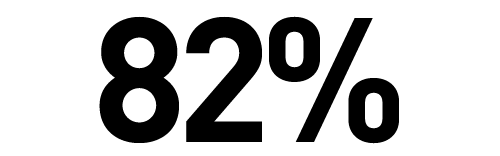
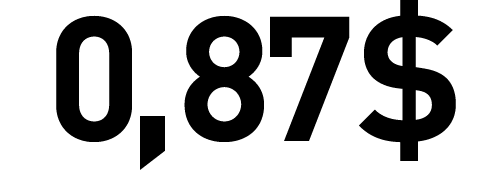
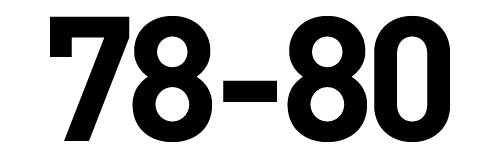
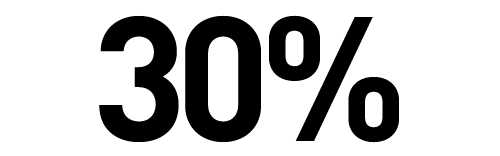
Mise à jour du statut
Cinquante ans après le dépôt des 167 recommandations de la Commission royale d’enquête sur le statut de la femme, nous faisons le point sur cinq de ses recommandations clés
PAR AMY VALM
Ouvrir la voie à l’équité
Le changement demande du temps, en particulier lorsqu’il est question de la lutte pour la parité hommes-femmes. Voici les individus et les événements qui ont préparé le terrain pour la Commission d’enquête sur la situation de la femme et son rapport historique
PAR REBECCA GAO
Toujours invisibles
Le rapport de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme a représenté un tournant décisif pour la parité hommes-femmes au Canada, mais il omettait la communauté LGBTQ. SARAH RATCHFORD explique que si nous avons fait de grandes avancées en ce qui a trait à la reconnaissance des personnes au genre non conforme, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche.

« Elle veut s’inscrire ! », a lancé à une collègue la réceptionniste de la clinique médicale de Halifax, tandis que je me tenais devant le bureau pour mon rendez-vous. Malgré le fait que les murs étaient tapissés d’affiches assurant que la clinique respectait les personnes queers et leurs pronoms, j’avais immédiatement été mégenré·e. Ceci m’arrive partout. Je suis non-binaire, ou enby, mais on m’a attribué le genre féminin à la naissance. En général, on ne demande pas quels pronoms je préfère. La plupart des gens présument automatiquement que je m’identifie en tant que femme. Certains de mes amis ont eu du mal avec mon changement de pronom, de « elle » à « iel », et la plupart des membres de ma famille ont décidé d’en faire fi.
Si plusieurs personnes de mon entourage ont eu du fil à retordre par rapport à mon identité, le gouvernement canadien parvient un peu mieux à se départir d’une vision binaire du genre au profit d’une conception plurielle.
Condition féminine Canada, en étant reconnu comme un ministère fédéral, a été renommé Femmes et égalité des genres Canada (FEGC). Les personnes transgenres sont désormais protégées en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne. Notre passeport peut être marqué d’un X pour signifier que nous ne nous identifions ni comme homme, ni comme femme, et pour la première fois, Statistique Canada va nous consigner dans son prochain recensement.

DORIS ANDERSON
En tant que rédactrice en chef de Châtelaine (1957-1977), Doris Anderson a été une défenseure de l’égalité. Elle a fait paraître un article de fond sur cinquante femmes qui feraient de bonnes parlementaires, et a mis douze de leurs visages en une pour inciter les femmes à se porter candidates. Ceci l’a menée vers une carrière en politique, et elle fut nommée à la tête du Comité consultatif canadien sur le statut de la femme. Elle devint par la suite présidente du Comité d’action sur le statut de la femme.
Ceci représente une avancée, compte tenu du fait que le rapport de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada n’abordait même pas la communauté LGBTQ, qui fait également face à des inégalités de genre et à plusieurs des mêmes enjeux qui touchent les femmes cisgenres. Mais si l’on y regarde de plus près, on constate que les changements des cinq dernières décennies sont insuffisants. Dans l’annonce officielle de sa création en 2018, WAGE déclarait avoir élargi son mandat « pour inclure la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de cette identité », mais les personnes trans et au genre non conforme n’étaient pas explicitement nommées. Il s’agit là d’un problème, car l’essentiel de la douleur que ressentent les personnes trans au fond d’elles-mêmes découle de l’effacement constant dont elles font l’objet. Ne pas nommer et inclure expressément les personnes queers, trans, au genre non conforme ou fluide, bispirituelles et non-binaires dans la discussion nationale sur l’équité de genre et de statut revient à entériner la violence continue contre ces communautés. Cette exclusion perpétue l’altérisation basée sur le genre que le ministère dit pourtant combattre.
Il est essentiel de nous inclure afin de nous garder en vie et en sécurité. À cause de l’effacement et de la discrimination constants à laquelle nous faisons face, on retrouve chez les personnes trans les plus hauts taux de pauvreté et de violence subie. Le Canada commence tout juste à inclure les personnes trans et non-binaires dans ses collectes de données, et les personnes trans sont souvent mégenrées au moment de la mort. Il est donc impossible de savoir combien de personnes trans ont été assassinées. À l’échelle mondiale, cependant, nous savons qu’au moins 331 personnes trans et au genre non-conforme ont été assassinées seulement au cours de l’année 2019.

FLORENCE BIRD
Après avoir passé la majeure partie de sa carrière à couvrir les droits de la femme, les affaires internationales et les iniquités salariales à Radio-Canada, Florence Bird a présidé la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967-1970). En 1971, elle a été nommée compagnon de l’Ordre du Canada et a servi en tant que sénatrice jusqu’à son 75e anniversaire.
Les personnes trans sont également davantage à risque de se suicider que les personnes cisgenres : en 2015, plus de 10 % des personnes trans affirment avoir fait une tentative de suicide. Près de 43 % des personnes trans ont tenté de s’enlever la vie au moins une fois au cours de leur existence.
Cela dit, les personnes trans, non-binaires et bispirituelles partout au pays se battent depuis longtemps pour être protégées et reconnues. Ce militantisme communautaire assidu a donné lieu aux changements que nous constatons à présent, maintenant que des modifications ont été apportées à l’échelle fédérale. À Toronto, des groupes comme Egale et The 519 exigent des politiques plus efficaces, une plus grande sensibilisation et une meilleure protection pour la communauté. Des figures notoires comme Monica Forrester, qui fait du travail de proximité avec le Maggie’s Toronto Sex Workers Action Project, et Susan Gapka, une éducatrice et militante pour les droits des personnes trans, élèvent leurs voix au nom de ces mêmes enjeux. Nous nous rassemblons afin d’organiser des manifestations trans partout au pays.
Au sein de nos communautés, nous passons beaucoup de temps à prendre soin les un···e·s des autres. Mais un changement à plus grande échelle est nécessaire. Tandis que nous soulignons l’anniversaire du rapport historique sur la situation de la femme, je pense qu’il est grand temps de préparer un autre rapport de situation, cette fois mené par les personnes queers et issues de la diversité de genre. Nous méritons la chance d’articuler nos besoins et de trouver des manières d’œuvrer à un avenir où nous serions visibles et où nous bénéficierions de soutien.
Lorsque les individus et les institutions parlent d’équité de genre et s’arrêtent aux hommes et aux femmes, elles démontrent qu’elles ont perdu le sens des priorités. Les personnes trans et au genre non conforme doivent être incluses explicitement. Pour nous, c’est une question de vie ou de mort.




